Les carnets de terrain de Darwin
Au total durant le Voyage, Darwin remplit quinze petits carnets. Il ne faut cependant pas les confondre avec les trois carnets postérieurs à 1836, également conservés à Down House. Hélas, le Carnet des Galapagos a été perdu dans les années 1990, probablement dérobé dans les collections de l'ancienne demeure de Darwin. Par chance, une copie sous microfilms avait été réalisée, mais l'original est une perte inestimable pour l'Histoire des Sciences. Vous avez peut-être également entendu parler des carnets "B" et "C" de Darwin, déclarés perdus par la Bibliothèque Universitaire de Cambridge en 2001 puis réapparus miraculeusement en 2022. On suppose qu'ils furent dérobés et conservés durant ces deux décennies par un mystérieux collectionneur privé, qui sans aucune explication les rendit en bon état et emballés dans un sac cadeau rose, avec dans une enveloppe jointe une carte souhaitant une « Joyeuses Pâques » aux bibliothécaires de Cambridge.
Mais revenons aux Carnets de terrain du Voyage (1831 - 1836). Leur existence publique est connue depuis la préface de Nora Barlow (petite-fille de Darwin) dans la première édition du Journal de Bord de Darwin (1933). En en publia par la suite dans son ouvrage Charles Darwin and the Voyage of the Beagle (1945) quelques descriptions assez détaillées. Il faut préciser que Nora Barlow fut la première biographe de Darwin à étudier ces carnets. Cette tâche fut laborieuse, tant l'écriture de Darwin est difficile à déchiffrer. Comme elle l'avoua, elle échoua à retranscrire certaines pages les plus indéchiffrables ! Outre les observations scientifiques, ces carnets conservent une interminable liste de petits détails du quotidien, de courses effectuées à terre, et de préparatifs d'expéditions. Darwin y crayonne également quelques pensées fugaces. Barlow elle-même avoua n'en avoir exploité qu'un dixième, laissant de côté les nombreuses spéculations géologiques de son grand-père. Sa petite fille écrivait avant tout pour diffuser la mémoire de Darwin auprès du grand public. En digne héritière de la lignée, elle était une généticienne et botaniste reconnue. Les notes de terrain géologiques de Darwin furent reprises par divers géologues, notamment au cours d'expéditions scientifiques sur les traces du grand naturaliste. Les Notes Zoologiques, compilations des sections consacrées des carnets, furent retranscrites par Richard Darwin Keynes, arrière-petit-fils de Charles Darwin.
L'étude des Carnets de terrain montre que le jeune Charles Darwin se considérait durant le Voyage avant tout comme un géologue; point de vue qu'il conserva quelques années encore après son retour. Plus qu'une simple habitude de terrain, Darwin considérait ses carnets comme le fondement même de la méthode scientifique sur le terrain. « Que la devise du collectionneur soit : "Ne faites pas confiance à la mémoire" ; car la mémoire devient un gardien capricieux lorsqu'un objet intéressant est remplacé par un autre encore plus intéressant » écrit-il en 1839 dans son Journal of Researches (première édition du Voyage d'un naturaliste autour du Monde). Il en fit même un précepte gravé dans le marbre, lors de sa contribution au Manuel de l'Amirauté (1849) :
« [Un naturaliste] devrait prendre l'habitude d'écrire de très nombreuses notes, non pas toutes pour les publier, mais pour se guider. Il devrait se souvenir de l'aphorisme de Bacon selon lequel la lecture fait un homme complet, la conférence un homme prêt et l'écriture un homme exact ; et aucun adepte de la science n'a plus besoin de prendre des précautions pour atteindre l'exactitude ; car l'imagination a tendance à se déchaîner lorsqu'elle traite de masses de vastes dimensions et d'un temps presque infini ».
La lecture des Carnets de terrain de Darwin demeure une activité difficile, comme nous en avait averti Nora Barlow ! De petite taille, ils sont recouverts d'inscriptions et de croquis parfois indéchiffrables. Il est évident que Darwin ne destinait nullement ces carnets à la publication. La chronologie même des inscriptions n'est pas toujours cohérente : il pouvait très bien poursuivre ses prises de note ultérieures sur un précédent carnet, sans aucune explication ! Après tout, qui d'autre que lui n'était destiné à les lire ? Le style est donc télégraphié, rempli de codes typographiques personnels. En plus de cette écriture griffonnées, ils contiennent pas moins de 300 croquis et gribouillages divers. Certaines phrases sont barrées, alors qu'il corrige ses pensées. Il manque parfois des pages, découpées par Darwin lui-même. Patrick Armstrong (2022) schématise ainsi la démarche rédactionnelle de Darwin. Le jeune homme débute par diverses observations. Il peut s'agir de relevés sur le terrain, tout autant que de tests minéralogiques, dissections, ou bien encore préparation des spécimens collectés une fois de retour à bord du Beagle ou dans une résidence temporaire. Toutes ces observations sont soigneusement rapportées dans ses carnets de terrain. Il peut se passer plusieurs jours avant qu'il ne reprenne ce matériel brut pour en rédiger un résumé, cette fois-ci au propre, dans trois journaux de bord : les Notes zoologiques, les Notes géologiques, et son Journal de Bord. Ce travail de synthèse l'occupe durant les temps morts du Voyage.
Une fois de retour en Angleterre, Darwin s'attèle à la publication finale de ces documents. Il n'est cependant pas question d'en livrer une copie fidèle, mais d'exploiter ce matériel pour en livrer si possible une interprétation scientifique. Comme le souligne Patrick Tort, il est alors crucial pour le jeune naturaliste d'asseoir sa respectabilité scientifique auprès de ses pairs. Darwin étant géologue de formation, il s'attaque en personne à ses Notes géologiques et aboutit à la publication de trois ouvrages majeurs : majeurs : "The structure and distribution of coral reefs" (1842), "Geological observations on the volcanic islands visited during the voyage of HMS Beagle" (1844), et "Geological observations on South America" (1846). Prudent sur ses connaissances zoologiques au terme du Voyage, il confie la rédaction des fascicules du "Zoologie du voyage du H.M.S. Beagle" (1838-43) à des spécialistes émérites. Il garde le soin de travailler lui-même sur les Cirripèdes (1846-54) ; probablement en raison de son intérêt de jeune étudiant pour la zoologie marine.
Quant à son Journal de Bord, il le destinait à sa famille proche; Darwin prenait d'ailleurs soin de régulièrement le poster (en complément de sa correspondance familiale) lorsque le Beagle faisait escale. Nous savons par les lettres de ses sœurs que son père, le Dr. Robert Darwin, appréciait plus que tout que ses filles lui en fassent la lecture. Le brave médecin de Shrewsbury, initialement réticent au projet de Voyage de son fils cadet, en tira cependant une grande fierté paternelle. Dès lors qu'il fut question de publier les Comptes-Rendus de l'expédition, le Capitaine FitzRoy proposa à Darwin de s'associer dans ce projet. Le jeune homme rédigea le troisième volume (1839), dont la seconde édition "Voyage d’un naturaliste autour du monde" (1845) nous est bien plus connue. Nous y retrouvons d'ailleurs, dans les ultimes corrections de Darwin, l'ajout de références aux ouvrages finaux de géologie et zoologie, mais aussi diverses allusions à sa grande théorie alors encore en gestation, la fameuse "transmutation des espèces". L'histoire des sciences se met ainsi en marche, sous nos yeux de lecteurs ébahis.
_-_Quarter_Deck_of_a_Man_of_War_on_Diskivery_(sic)_or_interesting_Scenes_on_an_Interesting_Voyage.jpg)
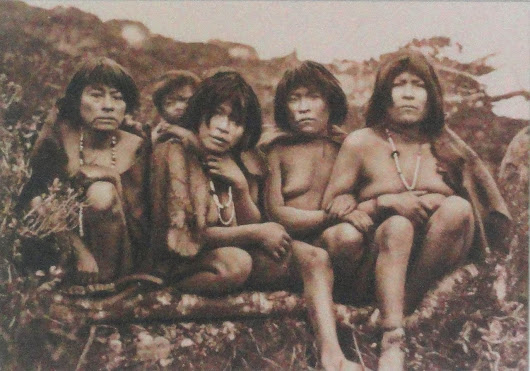


Commentaires
Enregistrer un commentaire